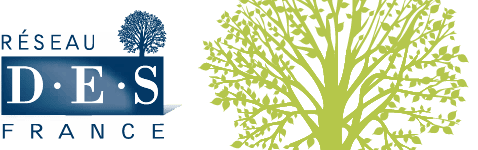Intervention d’Emmanuelle Brun, Vice-Présidente de l’association Réseau D.E.S. France, lors du Colloque « Faut-il repenser le droit des victimes d’effets indésirables de médicaments ? »
L’association Réseau D.E.S. France, créée en 1994, compte 2200 membres.
Le Réseau DES appartient à un réseau international qui regroupe des personnes concernées par le Distilbène°. Nous sommes une association orientée vers l’information et le soutien aux victimes de ce médicament.
Le Distilbène (diéthylstilboestrol), communément appelé DES, est un oestrogène de synthèse commercialisé en France par deux laboratoires et prescrit à environ 200 000 femmes enceintes de 1950 à 1977, pour prévenir des fausses-couches.
Inefficace, il s’est avéré nocif pour les 160 000 enfants, exposés in utero, et particulièrement les 80 000 filles, provoquant cancers et graves malformations utérines, d’où stérilité, grossesses extra-utérine, fausses couches tardives, accouchements prématurés, hémorragies du post partum. L’association a mené en 2014 une étude épidémiologique « DES 3 générations » qui démontre, entre autres, un taux élevé d’enfants Infirmes Moteurs Cérébraux, liée à leur naissance prématurée. C’est l’un des effets graves du DES sur la troisième génération.
Face à ces traumatismes insupportables, certaines d’entre nous demandent réparation. Nul doute que la reconnaissance de la qualité de victime participe d’une reconstruction de la personne. Il s’agit là de l’effet catharsis du procès en responsabilité. Ainsi, les procès DES sont pour la plupart intentés au civil.
Notre expérience nous permet de témoigner aujourd’hui des obstacles juridiques rencontrés par les plaignantes.
Les premières procédures ont été intentées en 1990 par des filles atteintes d’une forme grave de cancer : l’adénocarcinome à cellule claire (ACC).
Leurs difficultés furent les suivantes:
- obtenir que le droit français change car il ne prévoyait pas qu’une fille de la femme ayant absorbé le médicament puisse être reconnue en qualité de victime. (1)
- trouver des experts médicaux qui puissent se prononcer sur l’état des connaissances scientifiques au moment des prescriptions. Ces médecins ont travaillé pendant 5 ans pour établir un rapport(2) qui permettra par la suite aux juges de prononcer le manquement du laboratoire à l’obligation de vigilance.(3)
Il faut aussi toujours:
- établir la preuve de son exposition. Jusqu’en 2009, produire un document source (ordonnances, dossiers médicaux des mères) était indispensable, ce qui était loin d’être aisé étant donné l’ancienneté des faits. Depuis 2009, dans certaines situations, le dossier de la plaignante peut suffire à prouver son exposition.(4)
- démontrer le lien de causalité entre l’exposition et la survenue des préjudices d’où l’importance de l’expertise médicale. Expertise si souvent douloureuse pour les victimes par manque d’informations, d’explications et du fait de l’attitude très culpabilisante des laboratoires.
- agir dans les délais, sous peine de se voir opposer la prescription. Lorsque ces femmes exposées se décident à saisir la justice, il est parfois déjà trop tard au regard de la loi. Ceci est une source supplémentaire d’incompréhension de la part des victimes.
De plus, les laboratoires utilisent tous les recours possibles : la longueur des procédures épuise physiquement, psychologiquement et financièrement les victimes.
Je vous livre ces quelques lignes d’une « fille DES » qui relate son parcours dans la presse (5):
« (…) Nous avons saisi le tribunal civil en 2000(…). J’ai gagné mon procès le 31 octobre 2008. Le laboratoire a été condamné à me verser 26000euros. Mais il a fait appel et a gagné.
Je n’ai pas pu lire le compte rendu du juge tellement j’étais choquée. Médicalement, tout est prouvé. Le pire, c’est que pour me pourvoir en cassation il faut que je rembourse cette somme (…). Je rembourse 470euros par mois au laboratoire. Je gagne 1660euros par mois, c’est très lourd. J’ai déjà perdu pas loin de 15 000euros dans les frais de justice, que je ne récupérerai sans doute jamais. On paie tout : avocat, huissier, rapport médical, avoué, etc. Il faut être riche pour aller en justice, je ne le suis pas. Je suis épuisée financièrement et moralement, j’ai envie de passer à autre chose dans ma vie. Je me demande si je ne ferais pas mieux d’arrêter. Pour le Mediator, il y a une indemnisation. Pour le Distilbène, il n’y a rien. »
Combien de victimes du DES qui vont en justice obtiennent-elles de dommages et intérêts ? Question difficile car les procédures, comme je viens de le décrire, sont toutes complexes, individuelles, et longues (dizaine d’années).
Face aux nombreux témoignages similaires recueillis, nous sommes devenus partenaires de la fédération des accidentés de la vie, la FNATH, afin que les victimes du Distilbène puissent être accompagnées par des juristes spécialisés dans ce type de procédures. Notre objectif depuis notre création : l’information juste et indépendante afin que ces femmes puissent faire un choix éclairé notamment avant d’agir en justice.
Pour conclure mon intervention, je dirais que notre association est là pour aider, accompagner la réflexion. Avant d’être une réparation légitime, le procès est un véritable combat. C’est une épreuve judiciaire qui s’ajoute à l’épreuve médicale. C’est pourquoi nous militons au sein de ce collectif : pour que le précepte bien connu suivant lequel « l’union fait la force » trouve une réalité législative. Formulons le vœu, aujourd’hui, que le législateur en passe de voter la loi de santé entende notre histoire et dote, enfin, les victimes des effets indésirables de médicaments, de dispositifs favorables.
Notes et références :
1 : Neyret L. La reconnaissance du préjudice d’exposition au Distilbène note sous TGI Nanterre, 1re ch. B, 24 mai 2002, Revue de droit sanitaire et social 2002, p. 502.
2 : « Affaire DES : rapport général », ordonné par le TGI de Nanterre le 14 septembre 1994. Ce rapport fut rédigé par 4 médecins (épidémiologiste, pharmacologue, embryologiste et gynécologue-obstétricien) et 7 sapiteurs (3 épidémiologistes, 2 anatomopathologistes, 1 cancérologue, un Pr de médecine légale) et remis en février 1999.
3 : arrêt de la Cour d’appel de Versailles, du 30 avril 2004 : « (…)cette société a manqué à son obligation de vigilance et commis une série de fautes (…) » et arrêt de la Cour de cassation, du 7 mars 2006, qui a confirmé que le laboratoire UCB Pharma avait manqué à son « obligation de vigilance » (n’ayant pas tenu compte de « la littérature scientifique faisant état dès les années 1953-1954 de la survenance de cancers très divers et compte tenu d’expérimentations animales qui démontraient que le risque carcinogène était connu ») 4 : le 24 septembre 2009, la cour de cassation a rendu un arrêt pouvant faire jurisprudence dans les dossiers où l’exposition in utero au DES est reconnue par les experts, mais pour lesquels la plaignante n’apporte pas de « document source » . La Cour de cassation a estimé qu’il appartenait à chacun des deux laboratoires de prouver que son produit n’était pas à l’origine du dommage. Elle a donc inversé la charge de la preuve au bénéfice de la plaignante, et s’est prononcée ainsi sur une vraie question de principe.5 : Viva, le journal de ma mutuelle. Dossier « scandales sanitaires, la double peine des victimes », février 2012. Témoignage complet à lire sur : http://www.viva.presse.fr/Distilbene-Je-suis-epuisee_16664.html