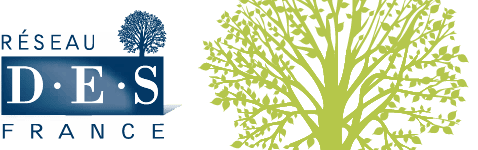Un dossier complet « Le DES et la justice » est accessible par la rubrique « Le Distilbène » de notre site.
Introduction
Deux arrêts rendus le 28 mars 2024 par la Cour d’Appel de Versailles (RG n° 21/05544 et RG n° 21/02528), ainsi qu’un arrêt rendu le 19 décembre 2024 par la Cour d’Appel de Paris (RG n° 23/14990) apportent des clarifications importantes sur la question du préjudice d’anxiété dans le contentieux du Distilbène (DES).
Ces décisions, qui concernent des femmes exposées in utero au DES et leurs mères, méritent une analyse approfondie tant pour leurs enseignements juridiques que pour leurs implications pratiques.
I. Contexte et enjeux du contentieux Distilbène
Le Distilbène (diéthylstilbestrol – DES) était un médicament prescrit aux femmes enceintes entre 1948 et 1977 pour prévenir les fausses couches. Il s’est avéré que ce produit causait des malformations et pathologies graves chez les enfants exposés in utero, donnant lieu à un contentieux important contre les laboratoires pharmaceutiques, notamment UCB Pharma.
Le préjudice d’anxiété constitue l’une des demandes récurrentes dans ces affaires : il s’agit de l’angoisse permanente ressentie par les personnes exposées face au risque de développer des pathologies graves (cancers, malformations, etc.).
II. Les principaux enseignements juridiques
A. La nature juridique du préjudice d’anxiété
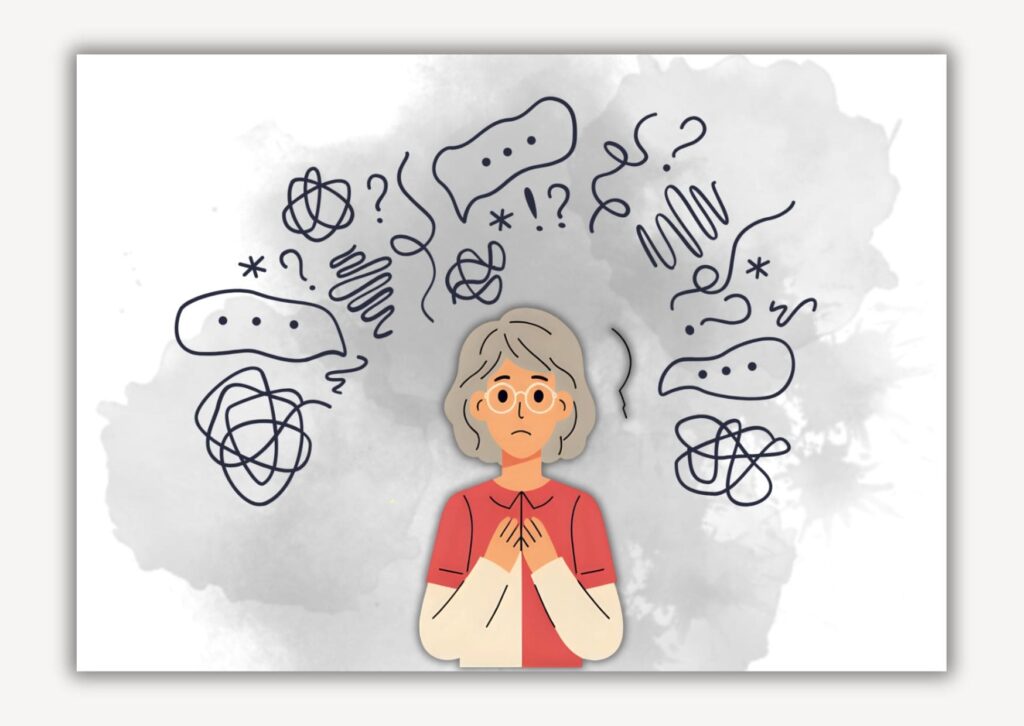
Les deux arrêts confirment de manière claire la position jurisprudentielle établie :
Le préjudice d’anxiété n’est pas un préjudice corporel mais un préjudice moral pouvant exister et être indemnisé même en l’absence de dommage corporel. Il résulte de la situation d’inquiétude permanente d’une personne confrontée au risque de développer une pathologie après avoir été exposée à une substance nocive.
Cette qualification emporte des conséquences importantes sur le régime de prescription applicable.
B. Le régime de prescription : un point de départ strict
1. Principe applicable
La demande d’indemnisation du préjudice d’anxiété se prescrit selon le droit commun (article 2224 du Code civil) : 5 ans à compter du jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
2. Détermination du point de départ
Les arrêts de la Cour d’appel de Versailles illustrent deux situations distinctes :
Premier arrêt (RG n° 21/05544) :
- Pour la fille exposée : prescription acquise car elle connaissait les risques depuis 1994-1995 (information reçue vers 21-22 ans)
- Pour la mère : prescription non acquise car le point de départ n’était pas établi avec certitude
Second arrêt (RG n° 21/02528) :
- Pour la fille exposée : prescription acquise car elle connaissait son exposition dès l’âge de 14 ans (vers 1981), même en tenant compte de la minorité
- Action intentée en 2015 : largement prescrite même en appliquant l’ancien délai de 10 ans
3. Enseignement pratique crucial
La connaissance de l’exposition et des risques fait courir la prescription, même si :
- De nouvelles études médicales sont publiées ultérieurement
- L’anxiété évolue dans le temps
- De nouveaux examens médicaux sont pratiqués
La Cour précise que ces éléments « n’ont pas généré une anxiété d’une autre nature donnant naissance à un préjudice distinct ».
C. Les conditions de fond du préjudice d’anxiété – un renforcement des exigences probatoires
Au-delà de la prescription, les arrêts rappellent que le préjudice d’anxiété suppose :
- L’exposition à une substance nocive présentant un risque élevé de développer une pathologie grave
- La réalité de l’anxiété personnellement subie avec des troubles anxieux démontrés
Dans le second arrêt rendu par La Cour d’Appel de Versailles, la victime n’a pu apporter « aucune pièce en mesure d’établir qu’elle a effectivement éprouvé une angoisse liée à sa connaissance des effets potentiellement néfastes du DES« .
L’arrêt rendu par la Cour d’Appel de Paris présente la particularité d’être rendu sur renvoi après cassation. La Cour de cassation avait, par arrêt du 15 juin 2023, censuré la Cour d’appel de Versailles pour défaut de motivation concernant le rejet du préjudice d’anxiété, estimant qu’elle n’avait « pas analysé, même de façon sommaire, les pièces versées aux débats ».
Ce qui reste positif c’est que la Cour reconnaît l’exposition de cette demandeuse à des risques avérés, en s’appuyant sur une documentation scientifique fournie :
- Risques de cancers : adénocarcinome à cellules claires, cancer du sein, cancer du pancréas, dysplasies cervicales
- Risques cardiovasculaires : coronaropathie et infarctus du myocarde
- Sources scientifiques reconnues : études de l’AFSSAPS, du National Cancer Institute, publications de recherche récentes
La Cour note que ces publications « sont suffisantes pour faire naître, chez les femmes effectivement exposées in utero à l’hormone litigieuse, une incertitude concernant leur santé à venir, susceptible de créer, chez elles, une anxiété particulière. »
Cela est très important en termes de jurisprudence !
Mais, pour l’affaire en question, la Cour a rejeté la demande d’indemnisation au motif que la demandeuse ne rapporte pas la preuve de son anxiété personnelle. Elle argumente :
- La demandeuse fait une simple affirmation : le DES a « hypothéqué » sa vie
- Aucune attestation de psychologue ou psychiatre
- Aucun témoignage de proches
- Et elle ne produit qu’un suivi gynécologique « classique » sans preuve d’anxiété particulière
La Cour indique donc que « la seule affirmation d’une angoisse liée à l’incertitude ou la crainte de développer à l’avenir une pathologie cancéreuse ou cardiaque du fait de cette exposition ne peut valoir preuve de sa réalité.«
III. Les implications pour les victimes du DES
Ces arrêts confirment la rigueur de la jurisprudence sur la prescription du préjudice d’anxiété. Il est essentiel de :
- Vérifier précisément la date de connaissance de l’exposition et des risques par le demandeur
- Documenter l’anxiété réellement subie (consultations médicales, attestations, etc.)
- Ne pas se limiter aux seules publications scientifiques récentes pour justifier l’absence de prescription
L’accent doit être mis sur la preuve de l’anxiété effective et personnelle, au-delà de la seule exposition
IV. Analyse critique et perspectives
Ces arrêts illustrent la tension entre la réalité médicale et sociale du préjudice d’anxiété et les exigences juridiques strictes de la prescription.
Si la position de la Cour d’Appel de Versailles paraît juridiquement cohérente, elle peut paraître particulièrement sévère au regard de la spécificité du contentieux DES (exposition ancienne, révélation progressive des risques)
Il conviendra de surveiller l’évolution de cette jurisprudence, notamment devant la Cour de cassation si ces arrêts font l’objet de pourvois.
Quant à la position de la Cour de Paris, l’on pourrait l’expliquer par la volonté d’éviter une « banalisation » du préjudice d’anxiété, et surtout le souci de distinguer l’anxiété légitime de l’anxiété indemnisable et enfin d’objectiver un préjudice par nature subjectif…
L’on peut légitimement se poser plusieurs questions :
- Proportionnalité des exigences : les critères ne sont-ils pas devenus trop restrictifs ?
- Accessibilité à l’indemnisation : toutes les victimes peuvent-elles constituer un dossier probant ?
- Évolution scientifique : comment intégrer les nouvelles découvertes sur les risques du DES ?
Conclusion
Ces deux arrêts de la Cour d’Appel de Versailles constituent des références importantes pour le contentieux du préjudice d’anxiété. Ils rappellent que, malgré la spécificité des affaires Distilbène, les règles de prescription de droit commun s’appliquent strictement, avec un point de départ fixé à la connaissance de l’exposition et des risques, non aux développements scientifiques ultérieurs.
La Cour d’appel de Paris rappelle que l’indemnisation du préjudice d’anxiété reste possible mais nécessite une démarche structurée et des preuves objectives de l’impact psychologique réellement subi.
L’évolution de cette jurisprudence méritera d’être suivie, notamment si ces arrêts font l’objet de pourvois en cassation, afin de vérifier si cette approche restrictive sera confirmée ou tempérée par la Haute Juridiction.
Dans l’intervalle, ces trois arrêts de la Cour d’Appel de Versailles et de Paris constituent des références importantes pour le contentieux du préjudice d’anxiété. Pour les praticiens, ces décisions imposent une vigilance accrue sur la prescription et une approche probatoire rigoureuse de l’anxiété personnellement subie par les demandeurs.
Article rédigé à partir :
- des arrêts de la Cour d’Appel de Versailles du 28 mars 2024, RG n° 21/05544 et RG n° 21/02528
- de l’arrêt de la Cour d’Appel de Paris du 19 décembre 2024, RG n°23/14990