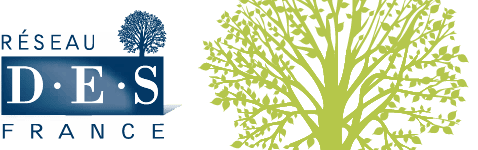Publié dans La Lettre de juillet 2009
Voici mon témoignage de grossesses alitées.
J’ai été enceinte une première fois et j’ai fait une fausse couche de deuxième trimestre à 4 mois et demi de grossesse. Là, le corps médical a bien voulu considérer la dimension « Distilbène ».
Mon moral était comme après un raz de marée, je n’avais envie que de pleurer, d’être enceinte à nouveau tout de suite malgré les mises en garde des médecins puisque j’avais subi un curetage. Entourée d’un mari très positif qui m’expliquait alors qu’il fallait se raccrocher au fait qu’être enceinte était possible !
La douleur d’ingérer les médicaments coupe lait…!
Le suivi de ma seconde grossesse s’est fait par un spécialiste « des grossesses à problèmes ». J’ai cessé mon travail au bout d’un mois à cause d’un décollement placentaire avec l’ “ordre” de me reposer au maximum. De drôles de sensations m’ont poussée à consulter (à presque 5 mois de grossesse, donc quasiment au même stade que la grossesse précédente) : modification du col, hospitalisation sous perfusion de salbutamol. (effets secondaires sur le rythme cardiaque, le cœur bat démesurément vite, bouffées de chaleur…) repos strict avec usage du bassin ! Une horreur absolue que je n’ai même pas pensé à contourner toute occupée que j’étais par les paroles incessantes répétées à mon ventre : « faut que tu tiennes ! » Mes veines étaient en compote donc un relais par voie orale a été choisi.
Hospitalisée près de chez moi, mon mari pouvait venir tous les jours, mes parents faisaient le déplacement ainsi que ma soeur et les rares amis qui passaient restaient peu car je devais être tellement taciturne, qu’ils ne savaient pas trop quoi me dire (moi non plus d’ailleurs, le ciel venait de s’effondrer partiellement !)
A 24 ou 26 semaines, je pouvais « prétendre à un grand prématuré » (non plus à une fausse couche tardive), j’ai été transférée au CHU de Grenoble dans le service de grossesses pathologiques. À nouveau perfusion (24h seulement) puis spafon et attarax (et quelques lexomil au début) car le moral n’était pas bon ! Mes muscles avaient fondu puisque je me rappelle que la première fois que je me suis pesée à Grenoble, donc vers 6 mois de grossesse, je n’avais pris que 500g par rapport à mon poids habituel. J’avais envie de sauter sur la balance.
Afin d’éviter une phlébite, un kiné passait régulièrement, je devais porter des bas de contention et mon mari me massait lorsqu’il venait (le mercredi et les week-end car Grenoble est éloigné de chez nous)
Mon moral oscillait alors entre périodes de découragement et discipline rigoureuse que je m’infligeait. (je suivais à la lettre le repos prescrit en lisant, brodant, écoutant la radio, profitant de la présence rassurante de mon conjoint), l’envie parfois de me mettre debout, de sauter pieds joints un grand coup et d’en finir.
Après coup je me suis dit que si j’agissais de la sorte c’était pour ne pas avoir à regretter, pour ne pas pouvoir me reprocher le moindre écart si l’issue avait été fatale. Chaque jour passant était un jour de plus qui nous éloignait de la prématurité et du handicap ! J’expliquais au personnel que j’étais contre l’acharnement thérapeutique tellement la peur du handicap est viscérale ! La réponse qui consistait à dire : « nous savons traiter la grande prématurité maintenant » ne me rassurait pas, je ne voulais pas et je continuais de dire à mon ventre inlassablement : »il ne faut pas lâcher » ! Je ne sais pas si la volonté a été un facteur aidant mais quelque chose me disait que rester couchée je pouvais, être séparée physiquement d’un bébé né trop tôt, je ne pourrais pas le supporter !
Afin de vivre au mieux cette période, je m’étais créé une journée pleine de rites : petit déjeuner, toilette (grand changement à Grenoble ! Le personnel considérait que laisser une femme se rendre aux toilettes, se doucher était un facteur positif pour le moral), broderie, écoute d’émissions à la radio, repas……..
La grossesse continuait à avancer, sont arrivées les piqures pour la maturation pulmonaire du bébé ! Ça faisait mal, ça rassurait sur la grosseur du bébé (cela voulait dire que les choses évoluaient) et c’était à la fois inquiétant de se dire qu’à nouveau le sort de ce bébé était lié à la chimie. Ce raisonnement je l’ai maintenant avec un peu de recul car qui sait si dans 20 ans on ne dira pas à mes filles : « il ne faut pas chercher, votre mère a pris de l’attarax et du salbutamol, voilà d’où viennent vos problèmes ». J’ai fait ce que ma mère avait fait, en pensant faire pour le mieux et j’espère qu’il n’y aura pas de conséquences.
Arrivée à 32 semaines je crois (temps légal où les services de grossesse pathologique gardent les femmes), je suis repartie à l’hôpital de Valence quelques jours dans de mauvaises conditions, j’en suis donc sortie avec sage-femme à domicile ! J’en avais assez mais je continuais avec ma rigueur. J’étais frustrée socialement de ne pas avoir pu montrer mon ventre de femme enceinte à la vie ! Je commençais à me mettre un peu à la verticale, marchant comme une mémé toute pliée, de crainte que la loi de la pesanteur ne soit la plus forte.
Mon mari travaillait, ma famille n’était pas sur place, la cantine du village me montait les repas chauds.
Ma fille est née à 10 jours du terme en pleine forme. Moi par contre, je m’étais fait une grande idée du jour où je me relèverai et là, la réalité ne correspondait pas aux attentes. J’étais fatiguée et fatigable, je n’arrivais pas à nourrir mon bébé mais je m’acharnais : un coup de tété au sein (badigeon de crèmes diverses et variées), un coup de biberon et ça recommençait. « J’étais énervée, fatiguée, mon bébé semblait dormir le moins possible et je souhaitais aller me coucher ! Pendant 4 mois je n’avais souhaité qu’une chose, me lever !
Je n’acceptais pas de ne pas y arriver, je n’acceptais pas de déléguer. C’était une erreur car je crois que pour s’en remettre au plus vite, j’aurais dû déléguer plus ou tout, mais je l’avais tellement voulu et tellement attendu ce bébé que je me faisais une haute opinion de ce que devait être mon rôle. Je ne supportais pas que quelqu’un d’autre que mon mari touche mon bébé. Je n’y arrivais pas, j’étais triste !
Je voudrais également parler des papas qui vivent silencieusement notre repos. Mon mari me disait après, qu’il était difficile pour lui d’être loin, d’avoir peur aussi, d’avoir eu le sentiment de vouloir prendre la grossesse pour soulager mon corps. Je sais vraiment que pour eux aussi, cette période est douloureuse.
2 ans et demi plus tard, nouvelle grossesse moins marginalisante socialement grâce à mes parents. Nous nous sommes installés dans une maison de famille voisine de la leur. Le midi je mangeais chez eux avec ma fille et le soir nous étions en famille. Ma fille allait chez une nounou 2 jours par semaine et ma mère et son papa la gardait le reste du temps. Nous avons choisi ce mode de vie lorsqu’on m’a fait un cerclage, soit vers 4 mois de grossesse. Cette grossesse était moralement moins difficile car je n’étais pas hospitalisée, je voyais plus de monde avec toutefois la frustration de ne pas profiter de moments variés avec ma fille.
J’étais suivi à domicile par une sage-femme dont je me servais de bouc émissaire.
La grande différence résidait dans le fait que je savais être capable de mener une grossesse à terme, j’étais donc moins rigoureuse avec là encore ce besoin de structurer mon temps dans la journée.
Là encore, j’ai mené la grossesse à 10 jours du terme (avec dans un coin de ma tête la question sans réponse : « arriver aussi loin, peut être aurait on pu faire plus simple, plus naturel ?!)
Suite à l’accouchement, hémorragie de la délivrance et transfusion. Fatiguée en profondeur, bien pire que la première fois (plusieurs mois de repos et transfusion), le gynécologue est arrivé dans ma chambre afin de m’expliquer qu’il fallait que je renonce à l’idée de nourrir ma fille, qu’il fallait que je me concentre un peu sur moi afin de retrouver des forces. Mon corps ce coup-ci m’obligeait à déléguer, j’étais trop molle.
Je crois savoir qu’en Afrique la parturiente est prise en main par sa famille, elle nourrit et câline son bébé, pour le reste, les autres s’en occupent ! Voilà à postériori le constat que je fais avec le recul, compris trop tard ! Mes filles vont bien et je ne regrette pas ces grossesses difficiles.
Lucie
Je viens de lire l’article de Lucie dans « la lettre » de juillet 2009. J’ai très exactement vécu ce qu’elle a décrit.
La différence est que mes fils ont aujourd’hui 23 et 19 ans. Et que lors de mes grossesses, de tous les médecins qui m’ont vue, aucun ne m’a parlé du distilbène. On m’expliquait soigneusement que je faisais un refus psychologique de grossesse… Il y en a même un qui m’a dit que je pouvais faire une « croix » sur mon bébé à cinq mois de grossesse, à l’hôpital Notre Dame de Bon secours à Paris.
Ce n’est que dix ans plus tard que j’ai appris l’existence de ce poison, notamment quand ma jeune sœur a eu les mêmes problèmes.
C’est étonnant, l’énergie que l’on peut déployer pour se battre et faire front, parfois contre beaucoup, pour faire triompher la vie. Ces périodes restent un grand traumatisme, j’ai la chance d’avoir deux beaux garçons, mais je n’ai pas eu le courage d’avoir un troisième enfant. Mon mari aussi aurait tant désiré en accueillir d’autres… Dans ma belle-famille où il y a beaucoup d’enfants, je reste une « paria psychotique » puisque je n’en ai que deux !
Je vais garder soigneusement cet article, parce que si un jour mes fils faisaient un travail sur eux-mêmes et que faisaient surface des souvenirs de leur vie intra-utérine, cela les aiderait à comprendre que, malgré tout ce que nous avons subi, ils étaient fortement désirés et qu’on a dépensé une somme phénoménale d’énergie pour atteindre les huit mois pleins de grossesse. Le jour où je me suis relevée, ils sont nés, pas gros mais en bonne santé.
Courage à toutes et à tous, ne pas se savoir seul(e) est déjà une grande aide.
Et que tous nos enfants vivent heureux !
Blandine