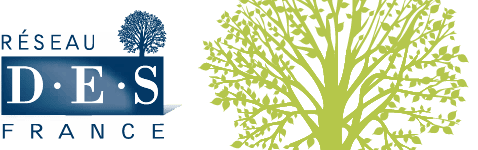Stéphane Vallégeas, membre du bureau de Réseau D.E.S. France, introduit la réunion.
Il présente Maître Felissi, avocat conseil auprès de la FNATH, l’association des accidentés de la vie. Tifenn Clément, secrétaire de l’association, Nathalie Lafaye, salariée de l’association, également présentes, ont participé à l’organisation de cette rencontre.
Il remercie également le Professeur Michel Tournaire de sa participation.
Rappel de l’historique juridique (Stéphane Vallégeas)
Les affaires Distilbène sont un facteur d’évolution du droit en France ; cela a été expliqué en détail par Laurent Neyret lors du colloque de 2010. Son intervention est en ligne sur notre site.
Plusieurs raisons rendent les procédures Distilbène (DES) particulières :
- les dommages sont causés à l’enfant exposé in utero,
- Les dommages ne sont pas visibles à la naissance, peuvent se révéler 15, 20 ou 30 ans plus tard.
- La génération suivante, celle des « petits-enfants DES », peut être concernée par la prématurité, avec risques de séquelles, donc de dommages,
Au point de vue juridique, les difficultés portent sur les preuves à apporter par les « filles DES » :
- preuve de l’exposition
- preuve du lien de causalité avec le préjudice subi.
Dans le monde, plusieurs laboratoires ont commercialisé le DES. En France, on en compte deux, qui sont devenus, au fil des années et des rachats, UCB Pharma (Distilbène) et Novartis (Stilboestrol-Borne).
En France, les procédures qui ont abouti ont été initiées auprès des juridictions civiles. C’est un point important : ce qui est recherché, c’est la responsabilité des laboratoires et non leur culpabilité (qui relève des procédures pénales).
Les premières procédures ont été lancées en 1991, par des jeunes femmes ayant eu un adénocarcinome à cellules claires (cancer ACC).
En 1994, un premier jugement a ordonné une expertise très complète. Deux axes ont été étudiés : d’une part, le lien entre exposition in utero au DES et la survenue d’un cancer ACC, d’autre part, l’état des connaissances scientifiques au moment des prescriptions.
Le rapport d’expertise a été remis en 1999, concluant que l’exposition in utero au DES constitue un facteur majeur de risque de cancer ACC.
Cependant, pour les dossiers DES, une expertise médicale est indispensable, épreuve extrêmement difficile à vivre par les victimes.
En 2002, un premier jugement a été rendu en faveur des plaignantes par le Tribunal de Grande Instance de Nanterre. UCB Pharma a fait appel.
En 2004, la Cour d’Appel de Versailles a confirmé le jugement condamnant UCB et retenu à son encontre une série de fautes (notamment le maintien d’un produit nocif dont l’inefficacité était connue en 1953). UCB Pharma s’est pourvu en cassation .
En 2006, la Cour de Cassation a rejeté ce pourvoi et confirmé l’arrêt rendu par la Cour d’Appel de Versailles. La Haute Cour a estimé qu’UCB Pharma avait manqué à son « obligation de vigilance ». Depuis, les points juridiques acquis grâce à cet arrêt bénéficient à tous.
En 2009 : des premiers jugements ont été rendus concernant des « petits enfants DES » nés prématurément. Le lien entre leur handicap et l’exposition in utero au DES de leur mère a été reconnu. Ce lien a été confirmé en 2011 par la Cour d’Appel.
En 2009, une autre décision très importante a été rendue par la Cour de cassation : un cancer ACC, sur la base d’une expertise, est reconnu comme une preuve suffisante d’une exposition in utero au DES. C’est un renversement partiel de la charge de la preuve, puisque, dès lors que la preuve de l’exposition est établie, c’est à chacun des deux laboratoires de prouver que ce n’est pas leur médicament qui est en cause. L’expertise a joué un rôle prépondérant, car elle a permis d’établir l’exposition in utero de la jeune femme concernée, en l’absence de « document source ». Il faut savoir que la littérature scientifique a établi qu’environ 60% des cancers ACC étaient liés au Distilbène, ce qui signifie que 40% de ces cancers n’étaient pas imputables au DES.
La Cour de Cassation a donc cassé l’arrêt, rendu par la Cour d’Appel de Versailles, qui avait été défavorable à la plaignante, et a renvoyé l’affaire devant une autre Cour d’Appel, celle de Paris.
En 2012, celle-ci a rendu un arrêt favorable à la plaignante, condamnant les deux laboratoires solidairement (50% chacun). Toutefois, l’un des deux laboratoires, qui ne détenait qu’une très faible part du marché (moins de 10%), s’est à nouveau pourvu en Cassation. Ce dossier, engagé en 2003, n’est donc pas terminé.
Malgré ces victoires, il faut savoir qu’il y a aussi des échecs. Entamer une procédure ne signifie pas que l’on aura gain de cause. Dans plusieurs dossiers, les plaignantes ont été déboutées, soit parce qu’elles ne rapportaient pas suffisamment la preuve de leur exposition in utero au DES, soit parce que les dommages subis n’avaient pas été mis en lien, par les experts, avec cette exposition.
En conclusion
- La production de « documents sources » reste un point important, même depuis l’arrêt de la Cour de Cassation introduisant un renversement partiel de la charge de la preuve.
- Si les atteintes les plus lourdes (cancer ACC, « petits-enfants DES » porteurs de handicaps du fait de leur prématurité, …) sont indemnisées, d’autres préjudices ne le sont pas, voire même pas du tout.
- Les procédures DES sont longues, nous l’avons vu, mais elles sont aussi coûteuses. D’où le choix fait par Réseau D.E.S. France de devenir partenaire de la FNATH. Cette association est une fédération nationale, présente sur pratiquement tous les départements, avec 1000 sections locales. Notre partenariat apporte la possibilité de faire étudier son dossier en amont avant de se lancer, puis, si on le souhaite, d’être accompagné pour un coût modique.
Le partenariat Réseau D.E.S. France / FNATH
Notre partenariat fonctionne depuis 2009/2010. Nous partageons des valeurs éthiques communes. La FNATH porte des combats auxquels Réseau D.E.S. France est attaché, comme par exemple celui des actions de groupe. Réseau D.E.S. France étant adhérent à la FNATH, en tant que personne morale, le coût pour une aide juridique n’est constitué que de la cotisation annuelle « conseil et défense » de 134 euros, somme modique par rapport à celle demandé par un avocat.
Ainsi, une analyse juridique du dossier est effectuée. Si une procédure semble possible, la personne peut décider, ou pas, de poursuivre avec l’aide de la FNATH. La Fédération complète alors le dossier, qui sera plaidé par Me Felissi. La personne signe une convention d’honoraires, mais là également, la somme est modique.
Me Felissi est habilité à plaider à Nanterre, TGI compétent, les sièges sociaux des deux laboratoires dépendant de cette juridiction.
2 questions récurrentes :
- Pouvons-nous garantir qu’une procédure va aboutir avec succès ?
Non, on ne peut jamais être sûr qu’une procédure va aboutir favorablement. Néanmoins, avec ce partenariat, on sait dès le départ si l’on a une chance ou pas d‘aboutir…
- Question de confidentialité : elle est garantie.
Débat autour de la preuve et de l’arrêt de la Cour de Cassation du 24 septembre 2009
Pourtant l’arrêt de la Cour de Cassation de 2009 montre que la preuve de l’exposition n’a pas toujours été exigée, dans la mesure où il s’agit d’une pathologie caractéristique du Distilbène comme dans les cancers ACC…
Nathalie : Malheureusement si, il faut apporter la preuve de l’exposition in utero au DES, c’est indispensable.
En 2009, la Cour de Cassation a rendu deux arrêts, concernant tous deux des dossiers de cancer ACC. Dans le 1er dossier, les médecins qui avaient soigné la personne avaient mis son cancer ACC en lien avec une exposition in utero au DES. Cela figure dans les comptes-rendus médicaux de l‘époque.
Dans le 2ème dossier, les médecins n’avaient pas mis en lien le cancer ACC de leur patiente avec une exposition in utero au DES. Dans les comptes-rendus médicaux, le DES n’est jamais mentionné. La Cour de Cassation a débouté cette personne.
Pourtant, ce n’est pas sur les faits que la Cour de Cassation a statué, mais sur l’application du droit : elle n’a pu statuer qu’à partir d’une formulation de l’arrêt rendu par la Cour d’Appel.
Nathalie : Oui, en effet, la Cour de Cassation n’a pas cassé l’arrêt de la Cour d’Appel, car elle n’a pas relevé de contradiction entre deux règles de droit sur lesquelles s’appuie l’arrêt, puisque dans ce dossier, l’exposition in utero au DES n’était pas établie, contrairement à l’autre dossier.
C’est d’ailleurs pour cela que la Cour de Cassation a publié un communiqué explicatif de ces deux décisions, qui, lorsque l’on ne dispose pas des éléments du dossier, paraissent contradictoires.
Stéphane : rappelons que 40% des cancers ACC ne sont pas en lien avec le DES. Cette marge d’incertitude importante bénéficie aux laboratoires.
Dans ce dossier, la personne a toujours été déboutée : au TGI, en Cour d’Appel, puis en Cour de cassation. Elle n’a jamais obtenu qu’une expertise médicale soit ordonnée. Cela montre bien l’extrême importance de ces expertises médicales.
Me Felissi : il y a, à mon sens, deux niveaux de débat : d’une part, ce que l’on peut retenir d’un arrêt de cour de cassation et en donner comme interprétation et d’autre part, ce que les personnes entendent et comprennent lorsqu’elles sont dans une situation donnée.
Je suis plus prudent, car une personne victime peut comprendre que, dès lors qu’il y a un cancer ACC, la preuve est établie. Je trouve cela dangereux, car cela laisse à croire qu’il n’est pas besoin de « travailler » un dossier, qu’une pathologie « signature » suffit. Un dossier se construit avec différents éléments et c’est une fois qu’il est constitué que l’on peut décider, ou non, d’aller en justice. Il y a beaucoup de raisons de ne pas partir en justice : c’est long, coûteux, c’est l’histoire d’une vie. Lorsqu’on voit le parcours de cette personne, quatre procès, et ce n’est pas fini… Moi je n’ai jamais envie d’engager des personnes dans des procédures qui vont durer 15 ans. On n’est pas, là, dans du droit commercial. Donc, dire de façon abrupte que dès lors que la Cour de Cassation a statué, c’est gagné, est dangereux. Dans une assistance où il y a des victimes, il faut rester prudent. Il faut donc cerner la motivation de la personne, car, de toute façon, on engage cette personne pour des années de procédures.
Dans le cas de l’amiante, lorsqu’une personne présente un mésothéliome, la littérature scientifique est tranchée: on sait que ce cancer est provoqué par l’amiante. Dans les cas des ACC, il n’y a pas la même proximité : lorsqu’on est dans un pourcentage 60-40, c’est plus délicat.
En 2012, la cour d’appel de Paris a examiné 2 dossiers :
Le premier dossier concerne la personne victime du cancer ACC, pour lequel la Cour de Cassation avait renversé la charge de la preuve. Lorsqu’on lit l’arrêt de la Cour d’Appel de Paris, on constate qu’un travail très pointu a été fait lors de l’expertise, avec argumentaire et contre argumentaire appuyés sur la littérature scientifique. Un vrai travail de fond a été effectué sur la recherche de la preuve et sur l’imputabilité.
Le second dossier ne concernait pas un cancer ACC, mais un parcours obstétrique difficile, la personne n’ayant pas réussi à avoir d’enfant. Cette personne a été déboutée, sans avoir pu obtenir qu’une expertise soit ordonnée, car elle est porteuse d’anomalies connues en dehors de l’exposition au DES, et elle n’a rapporté dans son dossier, que deux attestations de sa mère. Le dossier médical de suivi de grossesse de sa mère a été retrouvé, et il n’est pas fait mention de prescription de Distilbène.
Effectivement, lorsqu’on est en face d’une pathologie signature, le chemin est moins difficile, car il y a moins d’obstacles à franchir, mais je ne suis pas à l’aise avec la formulation qui consiste à dire que dès lors que l’on a une pathologie signature, le procès est gagné.
Réseau D.E.S. France m’a demandé de réaliser des vidéos explicatives de ces deux décisions, qui sont en ligne sur leur site internet : www.des-france.org .
La preuve de l’exposition…
Me Felissi : Il y a différents lieux et différents endroits : à la faculté de droit, dans un déjeuner entre confrères… on peut être très technique. Lorsqu’on est en face des victimes, je ne suis pas persuadé qu’elles vont faire le distinguo entre la preuve de l’exposition et le reste. Il faut faire attention, car les victimes ne vont pas entendre que c’est difficile, elles vont seulement entendre que la Cour de Cassation a indiqué qu’une pathologie « signature » est « suffisante ».
En fait, la cour d’appel, juridiction de fond, fait ce qu’elle veut, dans la mesure où elle est à même de faire une interprétation large ou pas des pièces qui lui sont soumises. La formulation même de l’arrêt qu’elle rendra, peut compromettre un recours en Cour de Cassation…
Me Felissi : en effet, nous sommes d’accord. Ce qui compte donc, c’est de travailler le dossier pour que les juges ne puissent pas interpréter les pièces de manière large ou restreinte.
Il faut travailler le dossier afin que les juges ne puissent pas prendre une position uniquement d’après les jurisprudences.
Question : pour un démarrage de procédure avec la FNATH, globalement, combien faut-il mettre de côté ?
Me Felissi : La convention d’honoraires figure sur le site de Réseau D.E.S. France. Les honoraires prévus sont de 1500 euros, ils peuvent être pris en charge par un contrat d’assurance de protection juridique, sans honoraires de résultats complémentaires.
A mon sens, ce qui compte surtout c’est que la personne soit en confiance avec l’avocat qui la défend. Il faut bien se mettre d’accord avec la victime sur les chances de gagner le dossier, car les dossiers DES sont très complexes et longs.
Débat autour de la date de consolidation …
La date de consolidation est devenue un point juridique important depuis qu’une réforme du délai de prescription l’a fait passer de 30 ans à 10 ans. Au delà de ce délai, aucune action judiciaire n’est plus possible. C’est donc le premier point à prendre en considération lorsqu’on aborde un dossier.
Comment la date de consolidation est-elle fixée, en règle générale ?
Me Felissi : Il n’y a pas de règle générale. La consolidation est une notion médico-légale : à telle date, quel que soit le traitement que l’on va proposer à la personne, son état ne s’améliorera plus, ni ne s’aggravera.
Ce n’est pas la guérison.
On peut avoir des soins post-consolidation, mais qui seront des soins d’entretien.
C’est une notion très adaptée à certaines pathologies, à des accidents, mais pour les maladies, c’est plus complexe.
Ce qu’il faut essayer d’obtenir, c’est que la date de consolidation soit fixée à la date d’expertise, notamment pour les cas de cancer ACC.
Est-ce que dans tous les dossiers de cancer ACC, la date de consolidation a été fixée à la date d’expertise ?
Me Felissi : Non, pas dans tous les dossiers.
Il faut se battre fermement à l’expertise pour que la date de consolidation soit fixée dans ce délai de 10 ans. Lorsqu’un dossier comporte de nombreuses pièces, il faut faire très attention aux pièces fournies, pour savoir ce qu’elles disent, ce qu’elle ne disent pas et ce qu’on peut leur faire dire.
Par exemple, si vous avez un document des années 90 qui fait état d’une exposition in utero au DES et d’une stérilité définitive : le premier élément est favorable, mais pas le second, qui tend à poser la date de consolidation à plus de 10 ans…
Vous avez indiqué que la date de consolidation n’est pas une date de guérison. Qu’en est-il lorsqu’on parle de rémission ? Il me semble qu’un médecin ne déclare jamais à un patient qu’il est en rémission avant plusieurs années…
Me Felissi : Pour avoir travaillé sur l’accès au crédit pour les personnes qui ont un risque de santé aggravé, à ma connaissance, le seul cancer où l’on peut être assez certain d’une rémission à une certaine date, est le cancer des testicules. On s’est servi de ces données scientifiques pour obtenir des accords avec des banques. Sur les autres cancers, je partage l’avis de dire « une rémission c’est quoi? ». Mais là encore, cela dépend du dossier : cela se travaille avec la personne et les pièces du dossier. Bien sûr, il faut lire la littérature scientifique sur les risques de récidive, mais dans les cas de cancer ACC ou du sein, moi je me battrai pour que la date de consolidation ne soit pas la date de rémission.
Pour une personne ayant eu connaissance de son exposition au DES en 2000, mais dont les médecins ont conseillé l’arrêt des tentatives de FIV en 2010, quelle date pourrait être retenue ?
Me Felissi : Effectivement, la connaissance du dommage remonte à 2000, mais la date de consolidation pourrait être fixée à la fin de la prise en charge médicale pour tenter d’avoir un enfant.
Un autre aspect qui devrait être pris en compte, ce sont les conséquences psychologiques de la situation vécue par la personne. Moi, je considère qu’un de mes rôles est de participer à faire évoluer le droit en vigueur. En tout état de cause, un avocat se doit d’être clair avec son client, lui expliquer les points forts et les points faibles de son dossier. Je pense à un dossier précis, pour lequel la date de consolidation est un point délicat. La date de connaissance de l’exposition in utero au DES remonte aux 18 ans de la personne. Elle souffre de stérilité, dont les médecins ont indiqué qu’elle était définitive il y a plus de 10 ans. En revanche, l’atteinte psychologique de cette situation devrait être prise en compte, puisqu’elle perdure : un suivi psychiatrique lui est toujours nécessaire. Pour ce dossier, nous allons argumenter sur le fait que la consolidation ne peut pas être considérée comme étant acquise.
L’important est de se mettre bien d’accord avec la personne concernée. Souhaite-t-elle, malgré ce point très délicat de la date de consolidation, pour lequel il faudra user de beaucoup d’arguments, se lancer dans la procédure ? C’est pour cela qu’il s’agit d’un vrai dialogue avec le client, avec ce qui figure dans le dossier.
Mais une atteinte psychologique qui perdure, c’est un point commun à toutes les victimes…
Me Felissi : Oui, enfin, dans le cas d’espèce auquel je pense, un suivi psychiatrique est toujours en place, ce n’est pas une « simple » psychanalyse qui est faite, donc on peut faire la preuve de cette vraie atteinte.
Une fois que les informations sont données au client, c’est à la personne de faire son choix, c’est du cas par cas. On n’est pas dans le cadre du droit commercial où les choses sont figées.
Mon enfant est ex-prématuré, avec troubles cognitifs.
Le lien entre sa prématurité et mon exposition in utero au Distilbène a déjà été reconnu par les juges. Toutefois, la détermination des préjudices liés à sa prématurité et par conséquent la fixation du montant de son indemnisation, sont fonction de sa consolidation. Or, les troubles cognitifs découlant de la prématurité peuvent évoluer jusqu’à l’âge de 25 ans, âge où le cerveau a terminé sa maturation. Les juges peuvent-ils prendre en compte la nécessité d’attendre cet âge pour fixer le montant du préjudice, et peuvent-ils accorder une indemnisation préalable afin de permettre à la victime de parer d’ores et déjà aux conséquences de sa prématurité ?
Me Felissi : S’agissant des enfants, on consolide plus tard. On attend en général leur majorité.
18/20 ans, c’est l’habitude, mais ça se travaille par dossier, avec l’expert. Même l’expert peut avoir du mal à fixer la date de consolidation, et à ce moment-là, il doit indiquer cette difficulté. Il doit tout de même nommer les préjudices, même s’il hésite sur cette date de consolidation. Car in fine, c’est le juge qui tranchera, mais pour ce faire, il doit disposer de tous les éléments, y compris des indications sur les préjudices.
La date de consolidation étant une notion médico-légale non figée, elle peut être fixée à 25 ans. Si l’on souhaite obtenir qu’elle soit fixée au delà des 18/20 ans, il faut argumenter en fournissant aux experts médicaux, aux juges, de la littérature scientifique. Il faut prouver que ces troubles cognitifs ne seront consolidés qu’à 25 ans. Cette question de la consolidation concernant des troubles cognitifs a été travaillée notamment dans des dossiers de personnes ayant subi un traumatisme crânien durant l’enfance.
En revanche, cela n’empêche ni d’obtenir des provisions, ni d’obtenir l’indemnisation de préjudices avant la consolidation. Par exemple, des provisions sur le sujet de la tierce personne. Le besoin de tierce personne n’est pas le même pour un enfant de 5 ans, de 10 ans, de 15 ans…
De manière générale, il faut reprendre contact avant les 18 ans de l’enfant. Cela peut être dès 16 ans, car il y a des choses à préparer. Une expertise n’est pas une chose que l’on subit. Souvent, je rencontre des personnes qui sont dans l’attente de leur l’expertise, sans l’avoir travaillée en amont. Or c’est un vrai travail qui se prépare avant que l’expert soit nommé, notamment dans la rédaction même de la mission d’expertise. Une mission d’expertise se construit avec l’histoire de la personne, ce que l’on va demander ? Il n’y a pas de mission type. Là encore, comment choisit-on l’expert : quelle(s) spécialité(s) ? Faut-il des sapiteurs ? (des experts techniques sur un/des points précis).
Débat autour de l’expertise médicale…
Remarque : je n’ai pas bien compris : normalement, dans nos expertises, c’est un collège d’experts qui est nommé d’office par le tribunal.
Non pas d’office, c’est à l’avocat de faire la demande de telle ou telle spécialité d’experts. Dans certains cas, on peut même demander des experts en particulier, dès lors qu’ils ont une compétence spécifique. Il n’y a rien d’imposé. C’est vous qui demandez au juge. C’est l’une des difficultés récurrentes : trop souvent, en matière de dommage corporel, la personne fait appel à un avocat non spécialiste des dommages corporels. Le risque dans ce cas est que la demande d’expertise soit une « mission type », qui ne sera pas adaptée à la situation vécue par la personne, qui ne demandera pas ce qu’il est nécessaire de demander.
La partie qui saisit la justice doit définir la mission d’expertise et ce, dès l’assignation. Ce n’est pas du « prêt à porter », mais de la haute-couture, du cas par cas.
Il faut faire le tour de tous les sujets à travailler, l’imputabilité… Les magistrats ne peuvent pas statuer « ultra-petita », c’est à dire au-delà de ce qui leur a été demandé.
Pensez-vous que les magistrats ne peuvent pas modifier un peu la mission d’expertise, en fonction des faits qui leur seront soumis ?
Non, je n’ai pas dit cela. Les juges témoignent qu’ils sont souvent confrontés à des situations qu’ils ne peuvent pas rattraper, des dossiers où seulement la moitié des choses leur ont été demandées. Dans ces cas, ils ne peuvent pas aller au delà, même si un dossier est mal ficelé. Evidemment, un magistrat intelligent et humain va faire en sorte d’ordonner une expertise plus adaptée à la personne que ce qui lui a été demandé.
Mais ce que je veux expliquer ici, c’est qu’une mission d’expertise n’est pas un document type trouvé sur internet, c’est un élément important qui se travaille en amont avec son client.
Il ne faut pas oublier que dans un procès, on est deux. Si un magistrat, dans la mission d’expertise qu’il ordonne, va au- delà de ce qui lui a été demandé, l’avocat de la partie adverse est tout- à- fait à même de pointer ces demandes « ultra-petita » et de les faire annuler. Il faut se rappeler que les laboratoires, dans les dossiers DES, se défendent vigoureusement et veillent à ce que le juge n’aille pas à au-delà de ce qui lui a été demandé.
Idéalement, il faut avoir son médecin recours avec soi, pour préparer l’assignation et la demande d’expertise. Eventuellement il pourra rédiger un memorandum qui sera soumis aux experts nommés par le tribunal.
Encore une fois, une expertise se prépare et construire son dossier avec un avocat, c’est faire toutes ces étapes-là. Une expertise n’est pas une chose que l’on attend et à laquelle on se rend avec ses radios dans le sac : cette attitude serait défavorable au dossier…
Possibilités de changer d’avocat…
Des personnes nous ont demandé si un changement d’avocat était possible, en cours de procédure.
Me Felissi : Un avocat n’est pas « Dieu le Père ». Il est possible de changer d’avocat.
Je conseille toujours aux personnes, avant de s’engager, d’aller voir un avocat, puis d’aller en voir un autre pour avoir un second avis, surtout s’il s’agit de préjudices lourds. C’est déjà un point important.
D’un point de vue déontologique, je ne peux parler que de ma façon de considérer mon métier et ma relation avec le client.
On se met d’accord, d’abord, sur les honoraires. Pour cela, on établit une convention d’honoraires. Cela peut être :
- au forfait : l’avocat vous dit « pour cette affaire, de A à Z, je vous prends tant. » Vous êtes d’accord ou pas d’accord.
- « Pour cette affaire, mon taux horaire sera de tant, et je pense devoir y consacrer tant d’heures. »
- Une pratique s’est développée au fil des années, celle de l’honoraire de résultat. Cela consiste à prendre une partie des sommes gagnées. Normalement, déontologiquement, cet honoraire ne doit pas être plus important que la partie fixe. L’honoraire de résultat ne doit être qu’un complément. Je peux comprendre le principe des honoraires de résultat, tant que le % n’est pas trop important et si vraiment la compétence de l’avocat choisi apporte une plus-value à la défense, que grâce à lui, les préjudices seront estimés de manière plus juste.
- Parfois, des avocats proposent un honoraire de résultat sans partie fixe : l’avocat vous dit « je vous prends 10, 15 ou 20 % sur les sommes gagnées ». A mon sens, ce système de rémunération n’est pas à recommander et doit alerter la personne.
L’idéal est d’avoir d’abord un devis écrit, avec plusieurs propositions de types d’honoraires, sur lequel on réfléchit. Ensuite, on signe une convention d’honoraires. Ce qu’il faut éviter, c’est de se lancer sans avoir évoqué le sujet de la rémunération et de se retrouver avec une convention qui, de fait, sera imposée.
Encore une fois, on doit choisir son avocat suivant son ressenti, comme on le fait pour un médecin.
Si l’on n’est pas satisfait, on a le droit de changer d’avocat.
La question est de savoir comment solder la convention d’honoraires en cours. Ce point-là peut être défini dès le départ, dans la convention : les choses doivent être claires dès le début.
Si l’on change d’avocat en cours de procédure et que l’on n’est pas d’accord sur le montant des honoraires restant dus, on peut saisir le conseil de l’ordre des avocats pour avoir une estimation du nombre d’heures de travail effectuées. Pour information : le taux horaire des avocats parisiens varie entre 250 et 450 euros HT.
Les faibles montants accordés au titre de l’article 700 font partie des éléments qui font que des avocats vont augmenter leur taux horaire, de même que les faibles rémunérations prises en charge par les assureurs. Mais on peut aussi être confronté à des abus. C’est aussi à chacun d’être vigilant sur les sommes qui lui sont demandées.
Comment doit-on procéder lorsqu’on souhaite changer d’avocat ?
Me Felissi : On peut contacter son avocat et faire un point avec lui. Si l’on voit qu’aucun accord ne sera possible, on le prévient de la décision de changement, par téléphone ou par courrier. Votre avocat peut vous rendre votre dossier directement. On peut également aller consulter un autre avocat, qui écrit à son confrère pour savoir s’il a été réglé de tous ses honoraires et s’il ne s’oppose pas à ce qu’il reprenne le dossier. Ce sont les règles déontologiques.
Si l’on change d’avocat, que peut-on légitimement récupérer comme documents ?
Me Felissi : L’intégralité des pièces du dossier doit être transmise.
D’autres questions nous sont posées quant à la preuve à apporter aux documents source, au lien de causalité …
Me Felissi : Ce sont des sujets récurrents.
Concernant la preuve de l’exposition :
En matière de faits, tout type de preuve est recevable, cela peut être des éléments concordants. Cela peut être les fameux documents sources : ordonnance ou dossier médical de suivi de la mère, registres de pharmacie, attestations des soignants de l’époque. Concernant les attestations de la famille, d’amis, de connaissances, de proches… il y a une jurisprudence assez établie.
Une attestation qui a été rédigée juste avant l’assignation ou en cours de procédure, par la famille, voire un médecin de famille, n’est pas un élément qui arrive à convaincre un magistrat.
Pour n’importe quel dossier, la force probante accordée par le juge à ce type de document sera faible.
Voici, par exemple, un extrait de l’arrêt rendu par la cour d’appel de Paris (cour de renvoi), en 2012, déboutant la plaignante. Les pièces versées sont :
- deux attestations de sa mère. Le tribunal indique : « outre qu’elles émanent d’un très proche parent, ces attestations ont été établies, la première, moins de 2 mois avant la délivrance de son assignation et la seconde en cours de procédure, circonstances qui tendent à en amoindrir fortement la valeur probante. »
- Le dossier médical de la mère qui avait été retrouvé, mais sans trace de prescription de DES.
- L’indication d’une malformation gynécologique connue en dehors de l’exposition in utero au DES.
Le pire qui puisse arriver à une victime est que son avocat ne soit plus son conseil, mais devienne son associé. Votre avocat doit être capable de s’opposer à vous si son avis est différent du vôtre.
Sans vouloir vous heurter, le DES n’est pas, pour la justice, plus extraordinaire qu’un autre type de dossier. Il faut apporter des éléments objectifs au magistrat pour qu’il estime qu’en droit, il y a bel et bien une exposition. Je n’ai jamais vu un dossier, bien travaillé et comportant des éléments probants, ne pas aboutir.
Si vous consultez un avocat et qu’il vous dit « on y va », sans avoir vu et étudié le dossier, il faut se méfier !
Concernant la preuve de la causalité :
Autre point primordial pour qu’un dossier soit présentable, c’est le lien entre l’exposition et la pathologie : il se prouve avec la littérature scientifique.
Lorsqu’on a une pathologie « signature », comme l’utérus en T ou le cancer ACC, c’est moins compliqué. Une pathologie comme le cancer du sein n’est pas une signature.
Certaines données scientifiques indiquent qu’il y aurait un risque accru de cancer du sein chez les « filles DES ». Si l’on a cette pathologie, mais qu’il y a des cas de cancer du sein dans la famille, que vont retenir les juges ? S’il y a d’autres causes possibles, que diront les experts ?
Me Felissi : Il m’est impossible de répondre à cette question.
Michel Tournaire : une étude américaine a trouvé un doublement de risque, lié aux doses prises par la mère. En cas de faible dose, le risque n’était pas significativement augmenté.
Une étude néerlandaise n’a pas retrouvé d’augmentation de risque de cancer du sein ; aucune information n’est disponible sur les doses prescrites aux mères.
Un travail d’analyse a été fait sur les doses, en France : elles étaient globalement moindres qu’aux Etats-Unis. C’est ce qui nous a décidés à répondre à un appel à projets de l’ANSM, pour tenter d’évaluer le risque de cancer du sein.
Pour cette étude, nous avons reçu, au total, plus de 10 000 réponses. Le dépouillement va commencer et nous ne pouvons pas préjuger des résultats.
Dans 60% des cancers ACC nous avons la preuve de prise de DES ; subsistent 15% de flous, pour lesquels l’exposition n’est pas certaine.
Les cancers du sein des « filles DES » ne présentent pas d’aspect particulier, contrairement aux cancers ACC du vagin ou du col utérin. On ne peut absolument pas préjuger des avis que rendraient ces experts médicaux… Une procédure est en cours aux USA, qui regroupe 53 « filles DES » ayant eu un cancer du sein.
Nathalie : concernant cette procédure américaine, après examen des dossiers présentés à la Justice, la juge en charge de l’affaire avait estimé qu’il y avait suffisamment d’éléments pour qu’un procès puisse se tenir. Dans ces cas-là, aux Etats-Unis, il est d’usage que des négociations amiables soient conduites : un procès ne se tient que si aucun accord n’est trouvé. Les négociations n’ayant pas abouti, le procès a commencé en janvier 2013, avec le cas d’une fratrie de 5 sœurs. Seule l’aînée n’a pas été exposée in utero au DES et n’a pas eu de cancer du sein. C’est donc le dossier de ces 4 sœurs « filles DES » qui était exposé au juge en premier. Le procès était programmé pour une durée d’un mois, il n’a duré qu’une journée. Eli Lilly, le laboratoire qui avait le plus de parts de marché du DES, a fait une proposition d’arrangement amiable, que les 4 sœurs ont acceptée. Cette proposition est restée secrète. Les autres femmes concernées ont été choquées de cet arrêt brutal du procès. La juge a ordonné que des négociations amiables reprennent. Mais la situation est bloquée, car Eli Lilly a déclaré dans son rapport annuel de gestion, qu’il estimait ces revendications sans fondement, et qu’il était déterminé à les réfuter vigoureusement. Nul ne sait comment cette situation évoluera, mais en tout état de cause, elle n’est pas très favorable aux victimes autres que ces 4 sœurs.
Me Felissi : sur un dossier comme celui-ci, on s’appuie sur les éléments scientifiques dont on dispose, mais, bien sûr, la partie adverse a la même démarche.
Est-il nécessaire de faire une recherche de gênes BRCA si l’on veut lancer une procédure suite à un cancer du sein ?
Pr Tournaire : la médecine a identifié deux gênes, appelés BRCA 1 et BRCA 2, en lien avec les cancers du sein. Une personne porteuse de l’un de ces gênes a un risque très augmenté de développer cette pathologie. Faire cette recherche de gêne BRCA, c’est tenter d’éliminer une cause connue de cancer du sein.
Me Felissi : Alors, oui, c’est une recherche qui est à faire avant l’expertise, même avant une assignation.
Est-ce que le préjudice d’anxiété est reconnu ?
Les femmes concernées par l’exposition in utero au DES ont toutes cette anxiété, car on ne sait pas quelles conséquences du DES nous allons vivre, si nos enfants vont en souffrir aussi…
Me Felissi : je ne l’ai pas vu dans les arrêts relus. Cela dit, il n’y a pas de raison de ne pas le demander ni de l’obtenir. Sur le préjudice d’anxiété, pour l’amiante, le fait de devoir avoir une surveillance médicale particulière, périodiquement, a été reconnu comme étant anxiogène. Pour le Mediator, en revanche, cela n’a pas été reconnu.
Y-a-t-il eu des procédures concernant des effets psychiques, au Civil, sur les enfants exposés ?
Les effets psychiques, ce n’est pas le préjudice d’anxiété… Une autre association, l’association Hhorages, essaie de faire reconnaître les effets de la molécule DES sur le psychisme des enfants exposés in utero.
Me Felissi : Non, à ma connaissance, cela n’a pas été tenté.
Pr Tournaire : l’association Hhorages a recensé un grand nombre de familles pour lesquelles il a été retrouvé une prise d’hormones chez la mère, durant la grossesse, et des troubles psychiques chez les enfants exposés.
Des études ont été menées sur ce sujet-là. La revue Prescrire, dont le sérieux est connu, a fait une analyse de la littérature publiée sur le sujet. La conclusion actuelle est qu’il y a un plus grand nombre de dépressions et de troubles du comportement alimentaire (anorexie, boulimie). On ne sait pas si la dépression est due à un effet direct, chimique, de la molécule ou si ce sont les conséquences des difficultés provoquées par le DES (infertilité, cancer, problèmes de grossesse…).
Une étude française est assez connue ; elle a été menée avec la cohorte E3N, par le Dr Verdoux, psychiatre à Bordeaux, sur des critères de tentatives de suicide, hospitalisations psychiatriques ouconsultations auprès d’un psychiatre. Cette étude a comparé des enfants exposés avec leurs frères et soeurs non exposés. Les résultats n’ont pas révélé d’augmentation de troubles entre les deux groupes comparés.
Me Felissi : oui, c’est un sujet d’importance. Si la preuve du lien de causalité était rapportée, la question de la date de consolidation serait à considérer autrement, pour les personnes concernées par ces troubles psychiques, bien sûr.
Pr Tournaire : une précision : l’étude en cours comporte des questions psychologiques rédigées en coopération avec l’association Hhorages.
Les « mères Distilbène » ont-elles plus de risques d’avoir un cancer du sein ?
J’ai moi-même été soignée ; pour les médecins, c’est un peu inexplicable, car il n’y en a jamais eu dans la famille.
Pr Tournaire : la plupart des cancers surviennent sans qu’il y ait des antécédents familiaux. En revanche, pour les « mères Distilbène », le sujet a été étudié, et il a été retrouvé un risque légèrement augmenté, de l’ordre de 30 à 35%. Mais on ne pourra jamais savoir si, en l’absence de la prise de Distilbène, vous auriez eu ce cancer. Il est difficile d’imaginer que, dans le cadre d’une procédure judiciaire, des experts médicaux estiment que la prise du DES serait la cause exclusive du cancer du sein, chez une « mère Distilbène ».
Où en sommes-nous de l’action de groupe ?
Me Felissi : Les textes adoptés par le Sénat il y a quelques années n’étaient plus d’actualité. Des associations de consommateurs craignaient que faire figurer l’action de groupe pour les victimes médicales, dans ce projet, ne le bloque dans son intégralité.
Les députés les plus militants pour l’obtention de la Class Action dans le domaine de la santé sont peu optimistes quant à une date proche de mise en œuvre.
La FNATH s’est déplacée au ministère de la justice, avec la revue Prescrire, Sophie Le Pallec de l’association AMALYSTE et le Dr Irène Frachon. Nous avons tenté, en vain, de les convaincre. Le ministère de la santé est pourtant favorable.
Le lobbying pour conserver un statut quo est très puissant, y compris chez les juristes, car ils ont peur que la notion de causalité soit niée, que l’obligation de la preuve disparaisse, qu’on soit dans le « tout indemnisation »…
Rappelons-nous les craintes suscitées par la loi de 1985 concernant les accidents de véhicules terrestres à moteur, où la preuve de l’imputabilité était très compliquée. Pourtant, depuis cette loi, les victimes sont indemnisées et il n’y a pas eu une « inflation » de dossiers, d’impact sur les assureurs, ni sur les constructeurs automobiles. C’est une avancée majeure. Un dispositif équivalent existe pour les accidents professionnels.
La FNATH fait du lobbying au plus haut niveau pour obtenir des avancées : nous avons été auditionnés, par exemple, par le Sénat, dans le cadre de l’affaire Mediator.
Je ne comprends d’ailleurs pas ce lobbying des laboratoires en faveur d’un statu quo. On pourrait augmenter le prix du médicament d’un ou deux centimes, mutualiser l’indemnisation, et ainsi régler le problème. Cette position n’est qu’une attitude pour préserver des profits à court et moyen termes.
Malheureusement, il n’y a pas, non plus, une volonté politique forte de régler la question.
Avoir obtenu l’action de groupe pour la consommation est peut-être la première étape pour obtenir son application dans le champ des dommages liés aux médicaments.
Nous devons aussi tenir compte des décisions européennes, puisque les directives européennes priment sur des lois nationales. Or, les laboratoires pharmaceutiques effectuent un lobbying européen particulièrement efficace, difficile à contrer. En effet, les associations sont peu organisées au niveau européen, en dehors du collectif Europe et Médicament, pour leur opposer un contrepoids suffisant.