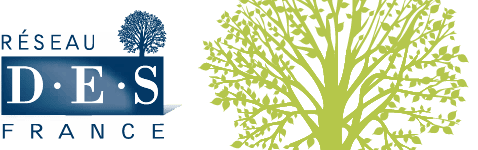Pour Le Monde, l’écrivaine évoque ses trois éprouvantes grossesses, passées, en tant que « fille Distilbène », allongée sans bouger pour ne pas perdre ses enfants.
Dès qu’elle en a l’occasion, notre Marraine évoque le Distilbène, les actions menées par l’association. Durant le mois d’avril, une dizaine d’auteurs, sollicités par Le Monde, ont raconté une expérience passée de confinement fécond. Marie a évoqué ses trois éprouvantes grossesses, passées, en tant que “fille Distilbène“, allongée sans bouger pour ne pas perdre ses enfants. L’évocation ce « confinement-DES » a profondément ému nombre d’entre vous, soulignant la résonance particulière pour les “filles DES“ de ce confinement 2020. Nous la remercions de nouveau chaleureusement de la parole qu’elle prête à nous toutes, victimes du Distilbène.
Le témoignage de Marie :
J’ai passé un an et demi de ma vie dans mon lit. Pour mes trois grossesses, au fil des années 2000. Cinq mois, puis six mois, puis sept mois. Plus un mois en 2007 pour un ou une qui n’est pas né, ce qu’on appelle laidement une fausse couche, et qui fut un vrai chagrin. Je suis une « fille Distilbène ». Le Distilbène, aussi appelé DES, une hormone de synthèse massivement prescrite entre les années 1950 et 1970, est tératogène : étymologiquement, il « crée des monstres ». L’écoulement des stocks alors que sa toxicité était connue causa un des premiers grands scandales sanitaires, après la Thalidomine et avant le Mediator. Il a fait 160 000 victimes en France, touchées par des malformations du système génital, un risque accru de cancers, et un très fort taux d’infertilité.
L’ironie tragique veut que ma mère, enceinte de moi, se vit prescrire cette molécule parce qu’elle avait perdu un premier enfant, et qu’on craignait pour elle une fausse couche due à l’angoisse. N’importe quel raisonnement semblait bon pour justifier le commerce de cette saleté. L’idée qu’on ait abîmé mon corps dès le ventre de ma mère me rendit, oui, hystérique : je voulais des enfants, plusieurs, et j’en aurais, je ferais mentir ce destin pharmaco-biologique, je réécrirais la tragédie. On me laissait peu d’espoir. Mon utérus minuscule, en forme de Y bizarre, évoque à l’échographie un estuaire filiforme aux branches zigzagantes. Cette beauté intérieure me força donc à garder strictement le lit pour porter mes enfants le plus longtemps possible : les deux premiers furent de grands prématurés, mais la troisième, née à huit mois, échappa à la couveuse.
Lors de ma première grossesse, je me levais de temps en temps pour prendre une douche et me faire réchauffer quelque chose, que je mangeais certes allongée (nausées garanties). A ce régime, mon utérus s’ouvrit sous le simple effet de la pesanteur et je fus hospitalisée à cinq mois et demi. Je passais les six semaines suivantes accrochée à une perfusion, dans un lit incliné tête en bas, interdite même d’usage des toilettes (je passai outre, en douce, mais avec terreur), farcie de crampes, puis sous antibiotiques, baignant dans mon propre liquide amniotique. La poche des eaux s’était fendue, le bébé était exposé aux germes, on ne m’approchait qu’avec masque et gants dans des conditions d’asepsie drastique. Chaque jour comptait : « Il est mieux là que dans une couveuse », me serinait-on – bref, je n’eus d’autre choix que de développer une riche vie intérieure.
La suite de la chronique de Marie est à lire sur le site du Monde.
À lire également : la page consacrée à notre Marraine avec un interview en vidéo.